Pages marocaines est publié le 25 août 1948 par la Galerie Derche à Casablanca, dans une édition accompagnée d’aquarelles de l’ami d’Henri Bosco, Louis Riou. Comme ces deux autres œuvres africaines, « Sites et mirages » et « L’Antiquaire », « Pages marocaines » est publié après l’arrêt de la revue Aguedal, dans le même objectif de faire connaître la richesse intellectuelle et spirituelle du Maroc. Elles profitent de la renommée et célébrité acquises par Henri Bosco après le prix Renaudot obtenu en 1945 pour « Le Mas Théotime », et ce n’est pas un hasard si « Pages marocaines » est produite par la Galerie Derche. Cette galerie tenue par Juliette Derche épouse de l’architecte et dessinateur Jules Henri Derche, qui a ses entrées auprès du roi du Maroc et des officiels français du Protectorat, est très prisée par les milieux officiels, et ses vernissages sont des évènements mondains importants rassemblant les administrateurs français et les intellectuels marocains. Deux ans plus tard, le texte des « Pages marocaines » est republié par Gallimard sous le titre « Des sables à la mer », avec un chapitre sur Meknès, « Quatre façons de voir les choses » en moins. De ce texte, une partie au moins, « Sanctuaire » sur le site de Chellah est largement antérieur à 1948 : une première version partielle parait en septembre et octobre 1941 dans la « Tunisie française littéraire » dirigée par Jean Amrouche à Alger. L’importance de certains extraits des chapitres « Sanctuaire » et « Chant pastoral d’hiver au Grand Atlas », doit être appréciée par rapport aux nombreuses publications après la « Tunisie française littéraire » : « Quatre-Vents » en 1942, « Tam » (« Tunisie, Algérie, Maroc ») en 1943, puis dans les « Cahiers du Sud » en 1947.
Ainsi, Gabriel Germain, dans son article consacré aux « Sables à la mer », « Incantations marocaines » dans le « Bulletin de l’Enseignement public du Maroc », peut-il mettre en avant l’action d’Henri Bosco pour révéler la richesse du Maroc : « Entre les sables et la mer, parmi les rudesses du ciel, des pierres et des hommes, un royaume de l’esprit vit à demi enseveli, qui ne demande que les chants appropriés pour renaître. Un jour il sera reconnaissant à ceux qui ont appelé l’aurore sur lui et, parmi eux, il se souviendra d’Henri Bosco. Qui verrait moins de sens à ce livre ne l’aurait pas compris ».
« Pages marocaines » est à la fois récit, poésie, méditation et réflexion mystique et raconte le périple d’un voyageur étranger sur les terres marocaines. Un récit de voyage pour lequel immédiatement Henri Bosco rejette le pittoresque et l’exotisme des récits orientalistes : « Rien n’est plus démoralisant que de décrire, ni plus vain. Le pittoresque nous égare, fausse le jugement et sous l’oripeau cache l’âme. Il faut, en pays exotique, fuir l’exotisme, et ne prendre de la couleur que sa vibration invisible, du décor fastueux et insolite que la féérie intérieure dont il provoque le rayonnement… » (« Des Sables à la mer », Gallimard, 1950, p. 30).
Le narrateur, qui n’est autre qu’Henri Bosco — comme le révèle le discours sur la ville de Rabat : « Il y a bien près de vingt ans que nous habitons dans cette ville. » (page 25) — atteint l’Afrique comme Ulysse rentrant à Ithaque après avoir affronté la mer hostile. Face à l’« antique table rocheuse qui émerge à peine des flots » (page 13), à la côte sauvage, peu hospitalière et solitaire, la terre primitive dont la côte n’est pas ouverture mais frontière, autant que le désert de l’autre côté, il ressent immédiatement le caractère sacré de ce pays « des sables à la mer ». Au milieu de ce pays sacré, se tiennent les montagnes de l’Atlas, « hauts lieux intacts [dont la] minérale pureté annonce d’autres puretés autrement inhumaines, et des au-delà de pierre et de ciel voués au silence » (page 17).
Au-delà du « Guide du voyageur », passant des villes de Rabat, Salé, à Casablanca, Fès, Meknès, puis se lançant dans l’ascension vers l’Atlas, Henri Bosco écrit « Un guide pour celui qui sait », un guide initiatique. Le chapitre central, et le plus important, lui-même divisé en trois parties, « Sanctuaire », se consacre à la nécropole mérinide de Chella, lieu sacré par excellence ceint de deux enceintes délimitant l’enclos sacré de la Khalwa, où le grand sultan Aboûl’Hassan Ali est enterré et où le légendaire Sultan noir commande aux génies. Ce lieu comprend jardin et fontaines dans une image du paradis et est donc un haut lieu spirituel : « Cette ville d’âmes, de ruines, de vieux arbres et d’eaux limpides repose ainsi sur des terrains spirituels d’une densité singulière ; et la vie qui s’y alimente participe à leur plénitude » (pages 86-87). C’est le point central du mouvement du visible vers l’invisible : déjà la ville de Rabat est décrite comme la capitale de la rêverie, où on ressent un état second entre la veille et le sommeil où « l’âme se dénoue, s’effiloche, se disperse et se fond dans l’être universel » (page 26). A Chella, « Ami, qui connais les mystères, avance, les yeux clos, ne tremble pas : tu sais » nous dit Bosco, citant le verset 98 de la sourate XVI du Coran. En ces lieux visités, vibre le monde, une présence qu’on ressent au travers des objets, ce « thambos » des Grecs auquel Henri Bosco a fait référence dans tous ces récits : « Ici l’on ne saurait poser d’apparence sensible, ni élever de rêverie qui ne décèle une présence délicate par un contact ou une inflexion indéfinissables. Nous sommes au royaume de la grâce intérieure, dans l’un de ces jardins du monde où l’on sent partout le génie du lieu. On ne le voit pas, mais tout fugitivement le suggère » (pages 63-64). De même, les maisons de Fès, ont une « vie qui rayonne sourdement et dont la force magnétique, si elle est favorable à votre présence, vous attire et vous fixe » (page 160). Et la plénitude de tous les objets vient de cette présence immatérielle, d’une âme : « rien ne sépare des choses, et, s’il en émane un parfum, une couleur, un sens, on les reçoit sans que s’altère la puissance de l’objet plein qui nous les a communiqués. Quoiqu’une âme mystérieuse s’exhale de toutes ces pierres, de tous ces végétaux et de cette source irréelle, ils ne perdent rien de leur force et plus nous en tirons de sensations, de sentiments et de pensées, plus leur présence est évidente, non par émanation de ces dons perceptibles, mais par rayonnement d’un fragment de réalité, dégagé de sa gangue et qui luit, or spirituel, substance inépuisable » (page 87). Dans « Pages marocaines », la musique est très présente, représentant cette vibration du monde : « Ici, monsieur, tout est musique : l’air, même le plus calme, le feu, fût-ce le feu qui immobilise le ciel, l’eau naturelle qui suit ce canal, et la terre, ce sol, l’humus épais dont la fertilité crée les tiges flexibles et les feuilles, cité des oiseaux, des insectes, des souffles […] Cette ville est musique. Et tout entière. Elle n’est que musique. La moindre pierre y chante et la moindre coloration. Rien n’y vit qui ne vibre, et l’onde sonore s’épand même de son silence. » (pages 129-130), explique au voyageur son hôte de Marrakech. C’est dans l’Atlas, embarqué au milieu du lac de Sidi Ali, que le voyageur conclut son expérience de l’invisible : son âme se détache pour devenir une « présence insaisissable » (page 182) plongeant dans l’abîme avant de connaître l’ascension, émergeant à nouveau des ombres et des eaux comme la lumière aurorale. Ce mouvement de descente et de remontée, d’anéantissement et de renaissance évoque la progression du catéchumène qui se débarrasse débord de son indignité avant de se recomposer purifié dans un état supérieur de Connaissance. Le dernier chapitre « Chant pastoral d’hiver » part lui aussi du visible, les pentes neigeuses, les tentes des nomades, les troupeaux de moutons pour le dépasser : « Je veux aller plus loin que vos tentes obscures » (page 210), pour atteindre l’absolu et le silence où le sacré se manifeste dans sa plénitude : « Tout est dit. Mon âme se tait. / Rien ne brisera plus la paix de mon silence. / Le désert, l’étendue et l’immobilité / ont desséché ma vie et brûlé ma substance. / Je ne suis plus celui que j’étais. » (page 213)
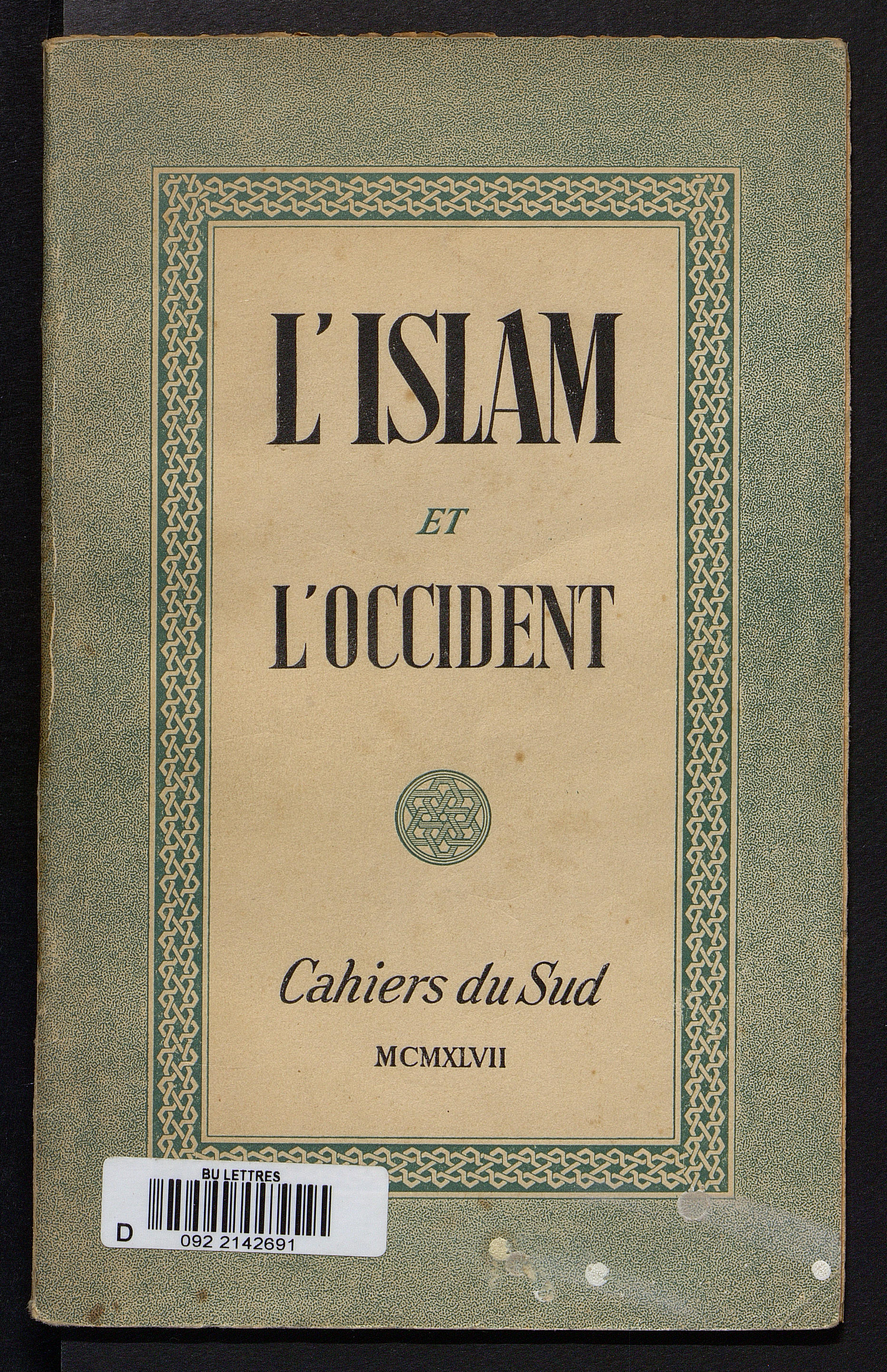 Chella
Chella Bonjean, François (1884-1963)
Bonjean, François (1884-1963)





